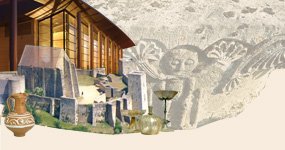Le donjon du château de La Madeleine à Chevreuse : une histoire révélée

Durant l’été 2010, une équipe du SADY a réalisé des sondages archéologiques dans le donjon. Il était un des rares espaces du château de La Madeleine encore peu exploré par les archéologues.
Trois ouvertures ont été faites dans le sol en terre battue afin de mieux connaître l’histoire de ce bâtiment considéré comme l’élément en pierre le plus ancien de l’ensemble castral. Jusqu’à présent, les historiens proposaient une date de construction située dans la seconde moitié du XIème siècle, car le donjon montre des contreforts sur sa façade plutôt plats, caractéristiques de cette période.
Les sondages devaient donc permettre de préciser cette datation en étudiant la fondation des murs du donjon. Les creusements de deux à trois mètres de large ont, pour cela, été placés contre les murs intérieurs au nord, à l’ouest et à l’est. Leur profondeur a varié selon le niveau d’apparition du substrat naturel (de 50 cm jusqu’à 2,50 m).
La fouille s’est avérée assez difficile en raison d’un sol très compact et sec, mais aussi avec la découverte de maçonneries qui a compliqué un peu plus les creusements.
De ces sondages, plusieurs informations inédites sont à retenir.
![]() Tout d’abord, la date de construction du donjon en pierre et, par là même, du château-fort est rajeunie.
Tout d’abord, la date de construction du donjon en pierre et, par là même, du château-fort est rajeunie.
Avec le sondage du mur nord, un fossé profond (environ 2,50 m) et de plus de 5 m de large a été découvert. Il suit l’orientation du mur nord ; plus précisément, il est dessous et a été comblé lors de la construction du donjon en pierre. Or, les fragments de vases qui y ont été retrouvés datent du milieu du XIIème siècle (vers 1160 - 1180). Ainsi, le donjon ne peut pas avoir été bâti au XIème siècle, il est plus jeune d’un siècle !
![]() Autre information intéressante, l’aménagement du donjon n’était pas celui que les chercheurs imaginaient.
Autre information intéressante, l’aménagement du donjon n’était pas celui que les chercheurs imaginaient.
Des contreforts intérieurs ont été découverts contre les murs ouest et est. Les mêmes avaient été mis au jour, lors de fouilles anciennes, au sud du donjon actuel, révélant d’ailleurs que le donjon était initialement plus long et qu’il s’était effondré. Ces maçonneries pourraient correspondre à des séparations internes de l’espace à l’aide de cloisons, aménageant ainsi des pièces bien distinctes au nord et au sud.
![]() Enfin, dans un des sondages (mur est) les archéologues ont mis au jour le squelette d’un chien assez âgé.
Enfin, dans un des sondages (mur est) les archéologues ont mis au jour le squelette d’un chien assez âgé.
La découverte ne serait pas si rare si l’analyse des ossements n’avait pas révélé que l’animal portait les marques d’une vie de chien de bât, utilisé pour transporter des charges lourdes (les pierres de la construction ?). Ils montraient également des impacts sur les côtes et l’omoplate auxquels l’animal a survécu. L’utilisation des chiens dans les travaux pénibles n’était pas connue jusqu’ici avant le XVIème siècle. De nouvelles perspectives d’étude sur les acteurs de la construction en pierre au Moyen Âge s’ouvrent ainsi.